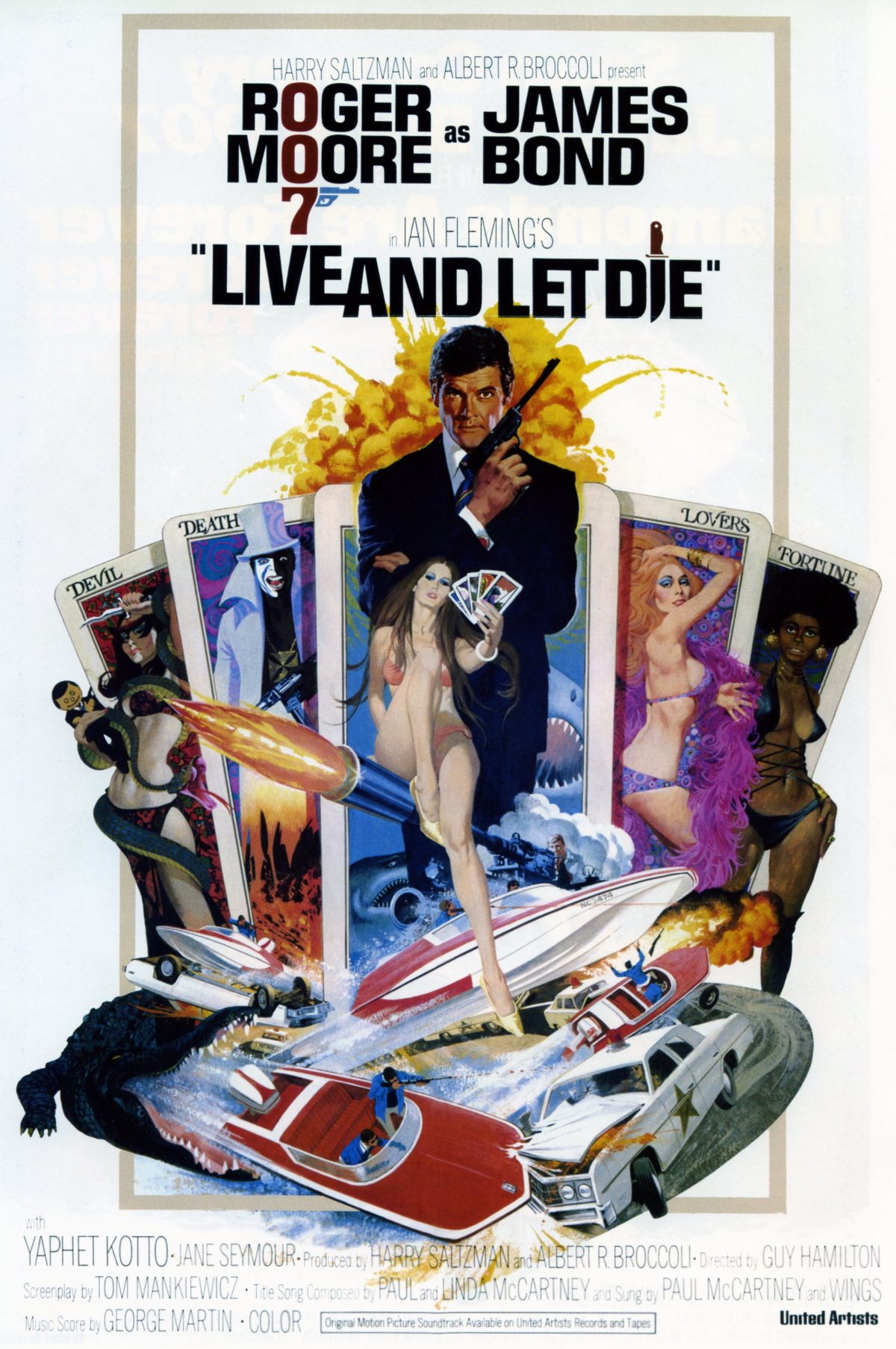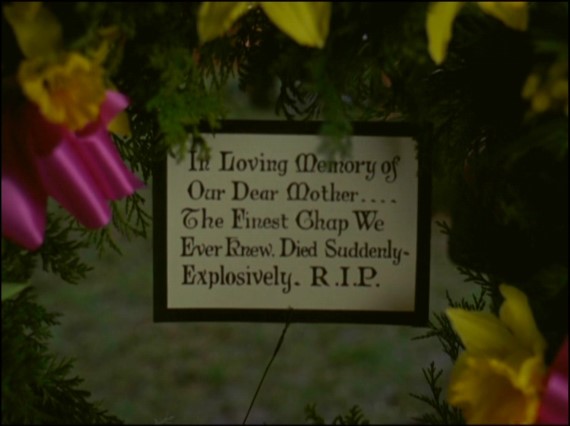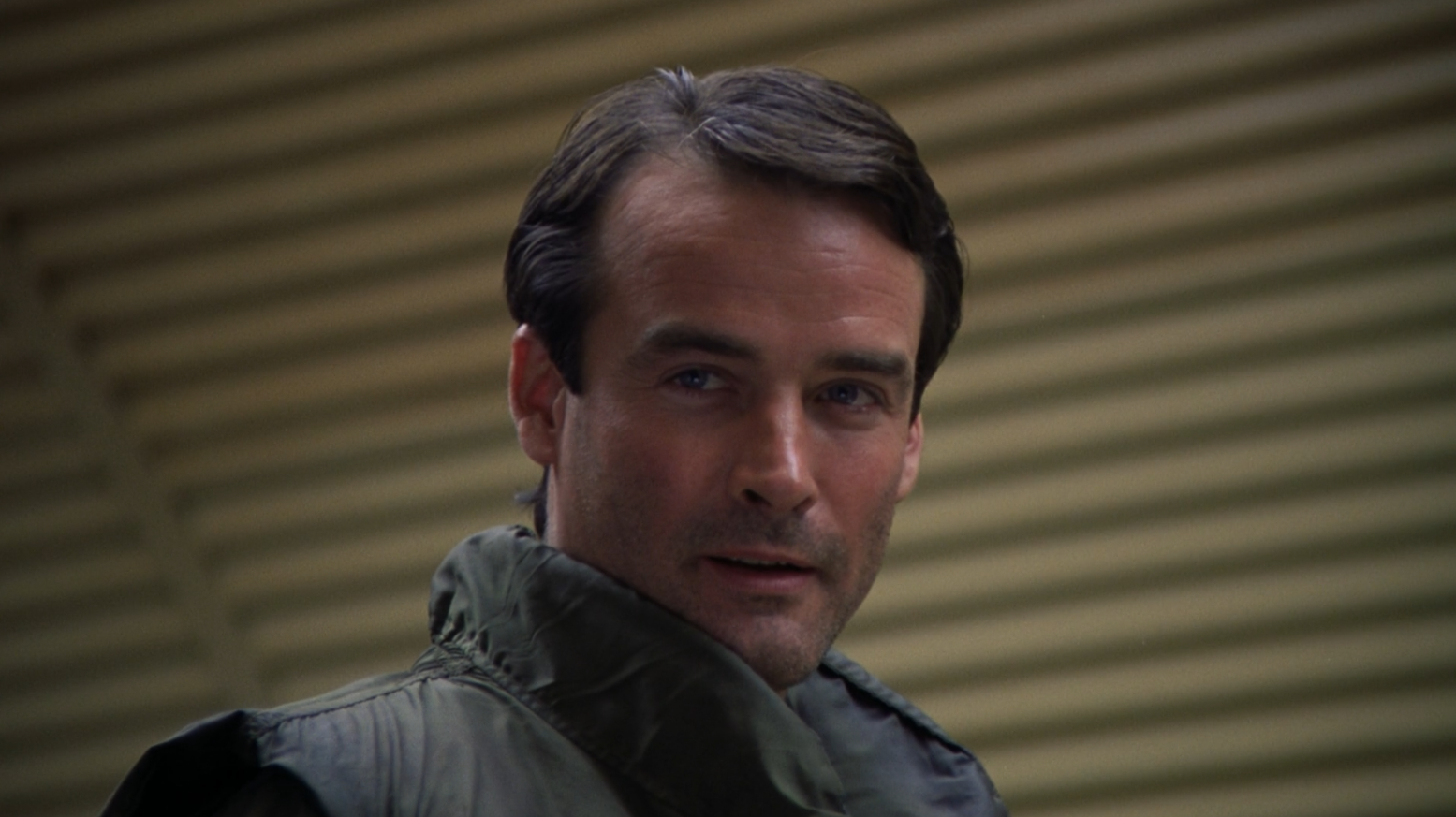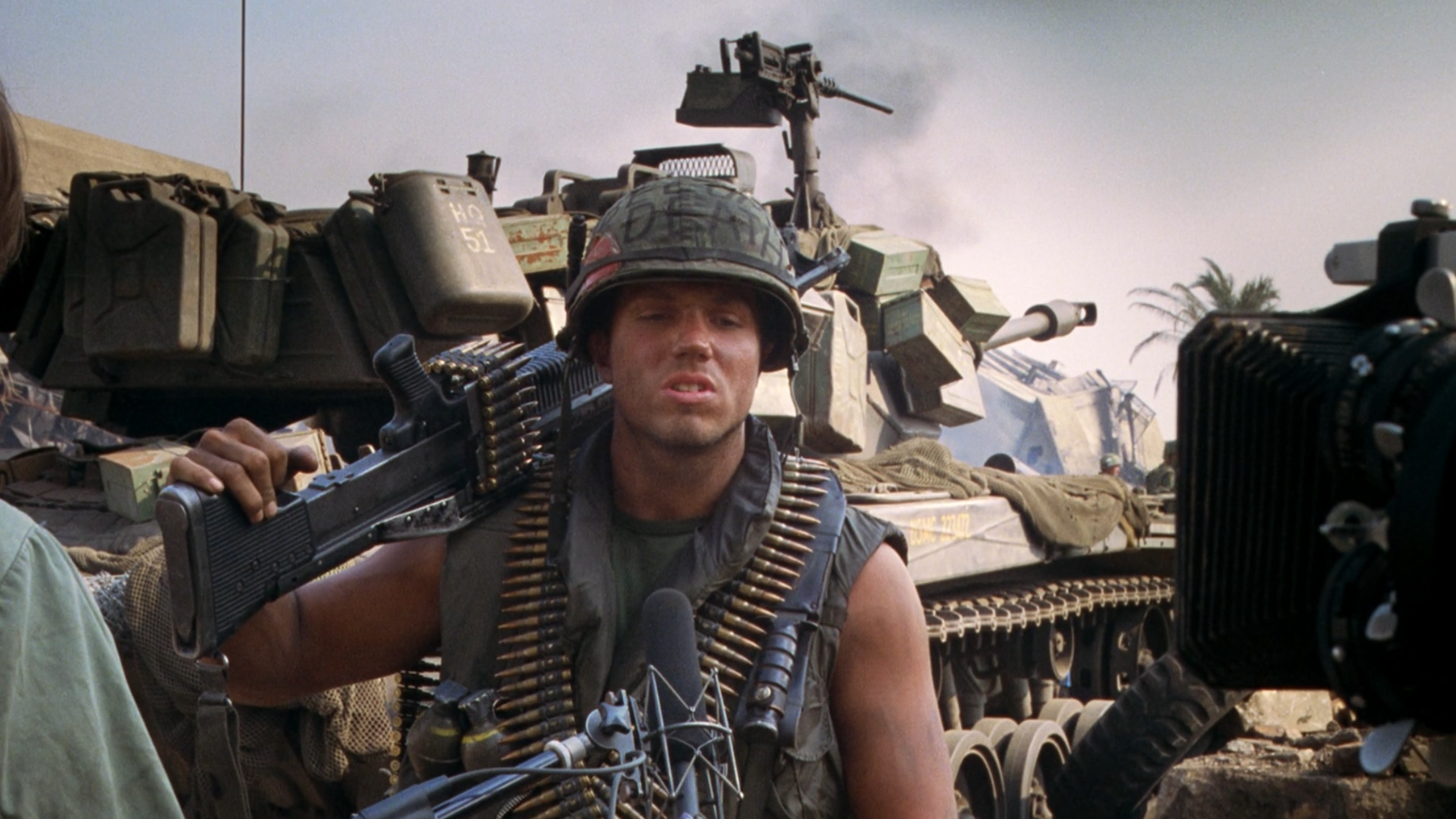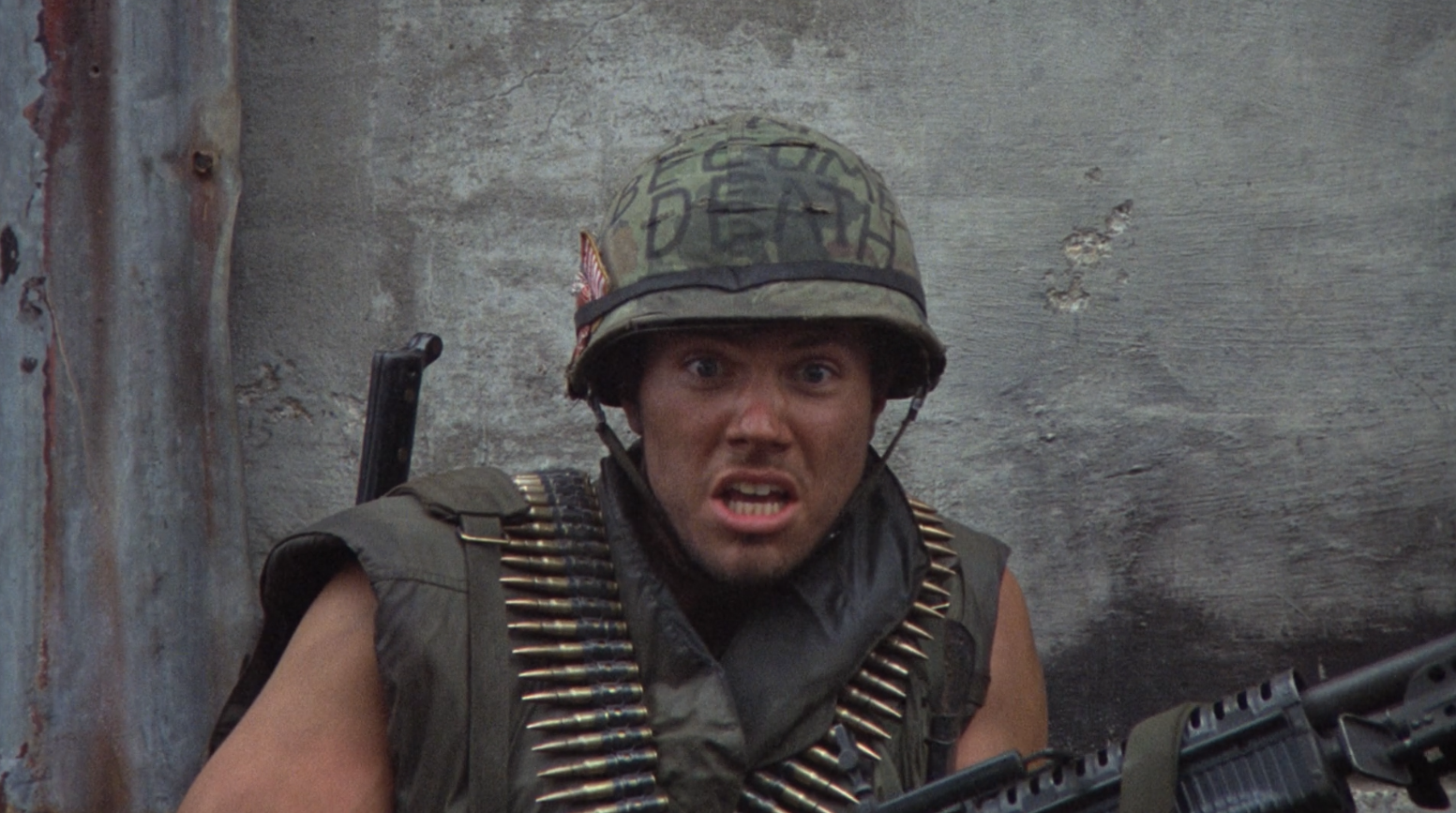*****************************************************
Dans la série des grands noms actuels du rock progressif, celui de Steven Wilson revient très régulièrement. À juste titre. Avec sous le coude des groupes tels que Porcupine Tree, Blackfield, Storm Corrosion, une réputation non usurpée de spécialiste de la remasterisation de classiques, de mixage 5.1, d’ingénieur du son subtile et exigigeant, Wilson cultive son image d’intellectuel accessible et multi-fonctions. Au-delà de son statut quasi iconique, le voici de retour avec “Hand. Cannot. Erase.”, quatrième album solo qui a l’honneur de succéder au magnifique “The Raven That Refused to Sing”. Mission impossible ?
Bonjour Steven. Pour commencer, revenons un peu en arrière et notamment sur ces deux dernières années et notamment sur le succès critique et public de The Raven that Refused to Sing. Avec le recul, que penses-tu de cette expérience ?
Steven Wilson : Je suis très fier de cet album. Il faut dire que tout s’est très bien passé pour moi. Le disque a très bien marché mais, pour être honnête, je ne l’ai jamais réécouté depuis sa sortie. Évidemment, je joue toujours les chansons sur scène, et j’en jouerais encore sur la prochaine tournée mais comme toujours dans ma carrière, malgré ce succès, je ne voulais pas me répéter, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Cela vient de mon habitude de vouloir évoluer, ne pas répéter systématiquement ce que j’ai déjà pu faire auparavant. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de « The Raven ».
Comment peux-tu expliquer le titre assez mystérieux de ce nouvel album : Hand. Cannot. Erase. ?
Steven Wilson : C’est un titre mystérieux, tu as tout à fait raison, et j’aime cet aspect étrange. Ce que j’apprécie avant tout lors de la conception d’un album c’est qu’il faut, à un moment, lui donner un titre. Quand tu donnes un « nom » à un album, tu le donnes également au public, tu leur dis « voici ce que raconte ce disque ». Et bien entendu, la plupart du temps, les chansons portent sur plein de choses très différentes qui ne peuvent pas se résumer à un mot ou une phrase. Je ne pouvais pas appeler l’album « The loneliness of living in the city » ou quelque chose dans le genre histoire de dire : « voilà de quoi ça parle » car l’album ne parle pas que de cela mais de plein d’autres choses : la perte, l’isolation, les nouvelles technologies, la solitude, l’amour… j’ai donc donné un titre qui n’est pas simple à comprendre, un titre ambigu, un titre que je ne souhaitais pas trop expliquer par ailleurs excepté le fait que le terme le plus important est ERASE. C’est l’histoire d’une femme qui, par son choix personnel, choisit de s’effacer elle-même de la conscience des autres. C’est tout ce que je veux en dire. Cela ne signifie pas plus pour moi. J’aime préserver derrière la façade.
Justement, quel est le concept derrière l’album ?
Steven Wilson : Le concept est vraiment centré autour d’une jeune femme à travers sa vie avec ce sentiment de n’appartenir à rien, d’être au bord de beaucoup de choses avec cette volonté de vivre dans une grande ville et, petit à petit, de s’isoler du reste du monde. En faisant cela, elle devient capable d’observer le monde moderne dans lequel elle vit. Mais elle finit par se perdre. Pour moi, c’est une opportunité d’utiliser ce personnage pour parler du monde moderne, pour parler des problèmes liés aux nouvelles technologies, de leurs impacts pour rendre nos existences meilleures, pour parler de la façon dont les villes, parfois, peuvent ironiquement isoler les individus malgré la masse, les faire se sentir seuls, pour parler de la façon dont Internet et les médias sociaux rendent paradoxalement les gens de moins en moins sociaux, antisociaux même, et pas mal d’autres choses encore. Mais globalement, c’est donc l’histoire de cette femme qui va en ville pour disparaître. Et personne ne s’en rend compte.

C’est une histoire étrange. Presque symptomatique…
Steven Wilson : Oui, et elle est basée sur des événements réels qui se sont déroulés récemment à Londres. Une jeune femme a été retrouvée morte dans son appartement après plus de deux ans. Ce qui était extraordinaire à propos de cette histoire c’est que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’était pas une vieille dame seule. Elle était jeune, jolie, populaire, avec des amis, et une famille. Et pour une raison inconnue, elle n’a manqué à personne pendant plus de deux ans. C’est incroyable. Mais cela a du sens pour moi car si tu veux vraiment disparaître, je crois que le meilleur endroit pour cela est encore de le faire en plein centre d’une grande ville…
C’est très paradoxal.
Steven Wilson : Et ironique, oui. Je crois que si tu veux être invisible, il faut te fondre au milieu de millions de personnes. C’est le moyen de disparaître. Elle est donc devenue très symbolique de ça, du chaos, de la confusion, de la vitesse de la vie au 21ème siècle.
Ces thèmes ont des similitudes avec des albums précédents comme Fear of the Blank Planet. Ce sont des choses qui vous inquiètent ?
Steven Wilson : Oui, bien sûr. C’était déjà inquiétant à l’époque de Fear Of A Blank Planet (ndr : 2007), mais les choses se sont empirées ! Ce sentiment de déconnexion que les gens ont avec Internet est vraiment inquiétant. C’est très facile maintenant pour un gamin d’obtenir tout ce qu’il souhaite sans sortir de sa chambre. Il peut discuter avec ses amis, jouer avec eux, télécharger de la musique, de la pornographie, etc. et je crois qu’il y a une tendance naturelle chez l’être humain à devenir passif. La technologie nous donne cette possibilité. On peut facilement devenir oisif. Pour moi, il y a une tendance croissante à s’isoler, à vivre à travers les univers virtuels. Ce n’est pas bon.
« Il y a une tendance croissante à s’isoler, à vivre à travers les univers virtuels et ce n’est pas bon. »
Le problème est peut-être une évolution trop rapide des technologies ?
Steven Wilson : Oui, absolument.
Nous n’avons pas le temps de nous adapter véritablement aux changements.
Steven Wilson : Regarde, chaque année les téléphones mobiles deviennent de plus en plus puissants, toute ta vie tient dedans. C’est incroyable la vitesse à laquelle tout évolue mais personne ne perçoit vraiment de quelle façon cela nous affecte. En bien ou en mal.
Cet album reprend la structure de The Incident (Porcupine Tree) : une chanson de 60 minutes découpées en plusieurs morceaux. Était-ce un principe de départ ou est-ce le fruit d’un accident, justement ?
Steven Wilson : Dès le début, je souhaitais faire un album concept et avoir un véritable axe narratif autour d’une histoire solide. Musicalement, ce n’est pas la chose la plus facile à faire. Quand tu as une histoire précise, que tu souhaites aller d’un point A à un point B, la musique devient esclave de ton histoire. Tu ne peux donc pas faire comme d’habitude et prendre, par exemple, telle ou telle chanson pour bien terminer l’album car il y a une narration à respecter. Tu es donc plus limité dans la façon de construire la musique. C’est assez compliqué mais aujourd’hui, j’ai vraiment besoin de cela, d’un concept narratif. Ce n’est pas tout à fait un album concept au sens classique du terme… disons que nous sommes plutôt dans un concept narratif. Il s’agit d’une histoire unique, linéaire, comme dans un film ou un roman.
As-tu écrit un script de départ ?
Steven Wilson : Je n’ai pas écrit véritablement de script et en fait, je n’ai pas écrit les textes avant d’avoir la musique. Tu sais, la musique et les textes sont le fruit d’un processus commun. Et je pense que c’est mieux, dans un sens, d’un strict point de vue de la musicalité. S’il y a un problème avec The Incident, dont tu parlais tout à l’heure, c’est principalement parce que la musique n’est pas aussi forte, aussi bien qu’elle aurait dû. C’est mon erreur, un échec personnel. Je crois que c’est un souci que j’ai résolu ici. J’ai appris des erreurs passées.
Précisément, la musique possède ici de nombreuses connexions avec vos travaux passés.
Steven Wilson : Oui, c’est exact. Il y a des chansons pop, des choses plus progressives, électroniques, heavy, folk, des passages plus atmosphériques… c’est bien de revoir tout ton répertoire mais c’est encore mieux lorsque tout cela est fait avec une histoire qui vaut le coup.
Cela ne t’a pas empêché d’essayer de nouvelles choses comme travailler avec une chanteuse. C’était la première fois ?
Steven Wilson : J’avais déjà travaillé avec des chanteuses mais plutôt sur des secondes voix. C’est effectivement la première fois que j’écris pour une chanteuse au premier plan.
« Ce disque est clairement un album studio… »
Peux-tu nous parler un peu de cette chanteuse : Ninet Tayeb ?
Steven Wilson : C’est Aviv Geffen qui me l’a fait rencontrer lorsque l’on travaillait sur Blackfield. C’est une star en Israël et une voix exceptionnelle, incroyable. J’ai essayé trois ou quatre différentes chanteuses pour ce projet et c’est elle qui m’a immédiatement époustouflé !
Était-ce compliqué d’écrire avec cet angle plus féminin, plus sensible ?
Steven Wilson : Compliqué ?… (il réfléchit)… écrire n’est jamais simple et pour moi c’est toujours compliqué de toute façon. Mais ce fut un vrai challenge d’écrire d’un point de vue féminin.

Je ne sais pas si j’ai réussi mais les femmes qui ont écouté l’album ont l’air d’apprécier. Mais en réalité, j’ai évidemment mis beaucoup de moi-même dans ce personnage. J’ai utilisé une voix féminine pour valider le choix narratif.
Un choix nécessaire…
Steven Wilson : J’aurai pu faire autrement mais cela permet évidemment de rentrer plus facilement dans l’histoire.
Et c’est aussi la première fois que tu utilises une chorale d’école ?
Steven Wilson : Oui, oui. C’était incroyable. Tu sais, ils ont parfois du mal à se concentrer longtemps sur quelque chose, mais lorsqu’ils chantent ensemble, cela donne quelque chose de magnifique et de très… féminin. La voix de jeunes garçons retrouvent cette sensibilité que je recherchais. C’était vraiment le bon projet pour essayer.
D’où vient cette idée ?
Steven Wilson : J’ai toujours été fan de Kate Bush et notamment de l’album The Dreaming, probablement mon préféré. Il y a une chanson sur ce disque « All The Love » où elle fait ce duo avec une chorale. Depuis, j’ai toujours eu envie d’en faire autant car c’est quelque chose qu’on entend très rarement dans la musique pop. De mémoire, je ne peux pas trouver un autre exemple. Il y a des chœurs d’écoles certes, comme dans The Wall, mais ils n’ont pas ce côté angélique d’une vraie chorale. C’est un composant intéressant et surprenant.
As-tu vu Kate Bush pour son retour sur scène ?
Steven Wilson : Oui, bien-sûr. C’était très psychédélique. Je ne suis pas forcément très amateur de tout ce côté théâtral exacerbé. D’habitude j’aime bien cela mais là, c’était tellement énorme. Cela dit, elle était exceptionnelle ! Une voix toujours incroyable. Le show était très ambitieux. Quasiment tout était parfait.
Quel fut le processus créatif pour Hand.Cannot.Erase ?
Steven Wilson : La différence avec The Raven s’est surtout faite à partir du moment où nous sommes entrés en studio. Ce disque est plus un album studio. The Raven était plus un disque live enregistré en studio dans le sens où lorsque tu l’écoutes, tu écoutes six personnes qui jouent ensemble. Nous étions très peu dans le montage, la post-production, ce genre de choses. Pour Hand.Cannot.Erase ce fut beaucoup plus compliqué car nous étions dans un processus de construction en studio. Il y a eu bien plus de manipulations sonores, de sons électroniques et cela était nécessaire dans le sens où ce processus reflétait l’histoire racontée. C’est une histoire du XXIème siècle qui se déroule dans une métropole, avec un côté industriel amené par les textures électroniques. Cela aurait compliqué de tout faire en live au sens figuré.
C’est la raison pour laquelle tu n’as pas retravaillé avec Alan Parsons ?
Steven Wilson : Oui. Quand j’ai travaillé avec Alan, je voulais vraiment ce son « old school » et vintage, une production seventies. Et pour cet album je cherchais quelque chose de très différent.
Je crois savoir que tu ne sais pas lire la musique, ni même l’écrire…
Steven Wilson : Exact.
Comment fais-tu pour élaborer un album ?
Steven Wilson : C’est facile de nos jours ! Il suffit d’enregistrer avec ton ordinateur, avec un piano, par exemple, et l’ordinateur retranscrit tout. Je suis chanceux dans le sens où je travaille à une époque où la technologie nous aide. Je suis malchanceux dans un sens mais chanceux dans un autre. Je peux jouer un morceau au piano, l’enregistrer et l’envoyer à Adam Holzman. Le fait de ne pas savoir lire ou écrire la musique n’est donc pas un obstacle insurmontable.
Quelles furent tes influences pour cet album. J’ai noté Boards of Canada par exemple…
Steven Wilson : Rush également et aussi Pete Townshend, sur le premier riff et sur l’aspect conceptuel de l’album. Je pense qu’il est le grand-père des grands concepts albums sur l’aliénation. Si je te demande quel est l’album où le personnage principal a un père présumé mort à la guerre, grandit dans la solitude et l’aliénation… de quel disque s’agit-il ?
Tommy.
Steven Wilson : Oui, mais beaucoup auraient répondu The Wall car c’est le même concept. C’est pourquoi je pense qu’il est le grand-père des albums conceptuels basés sur l’aliénation due à l’ère moderne. C’est précisément le sujet de Hand.Cannot.Erase. Musicalement, il y a d’autres influences évidemment, comme Kate Bush, Boards of Canada, et beaucoup d’autres inconscientes.
Tu écoutes toujours beaucoup de musiques très différentes…
Steven Wilson : Je sais que certaines musiques, certains morceaux m’influencent mais on ne peut pas forcément le remarquer. Par exemple, certaines parties de l’album sont influencées par Magma mais personne ne s’en apercevra sauf moi car je le sais. Quand tu écris, tu es toujours sous influence mais tu ne t’en rends parfois même pas compte.
« Je me sens plus auteur que musicien… et puis, les musiciens qui m’entourent sont bien meilleurs que moi ! »

J’ai noté que tu avais récemment écouté la bande originale du film Interstellar.
Steven Wilson : La musique est magnifique. J’avais également adoré le travail de Hans Zimmer sur Inception, c’était brillant, fantastique.
As-tu vu les films ?
Steven Wilson : Inception est un film génial. Interstellar est très spectaculaire mais l’histoire est ridicule, enfin, je n’ai pas tout compris. Avec Inception, Nolan a fait le plus incroyable blockbuster : très intelligent, très malin et dont tu peux apprécier chaque niveau. J’ai adoré également Le Prestige, Memento…
Il y a deux ans, nous nous étions vus pour The Raven et à ce moment-là tu m’avais dit vouloir travailler pour le cinéma. As-tu des projets dans ce sens ?
Steven Wilson : J’adorerais mais je n’ai rien de prévu pour le moment malheureusement.
Tu m’avais avoué ta préférence pour des univers à la David Lynch…
Steven Wilson : Oui, mais la plupart de ces réalisateurs ont leur compositeur attitré. Nolan a Zimmer, Lynch Badalamenti, Tim Burton a Danny Elfman, David Fincher a
Trent Reznor… il faut donc trouver un réalisateur qui n’a pas encore de connexion. Ce n’est pas simple. Mais j’adorerais le faire un jour.
Il suffit de la bonne occasion.
Steven Wilson : Oui, je sais que ça arrivera un jour.
Qui est l’auteur de la pochette ?
Steven Wilson : Lasse Hoile.
C’est assez inhabituel de son style.
Steven Wilson : Oui. Il a mélangé peinture et photographie. Le résultat est superbe. Nous avons travaillé sur ce concept car le personnage de mon film (ndr : il sourit sur son lapsus)… enfin de l’album… est une peintre. Cela donne une vision très fraiche de l’album.
Ton lapsus est intéressant. Te sens-tu plus un auteur ou un musicien ?
Steven Wilson : Oh… un auteur. Bon, c’est un grand mot évidemment, mais si par auteur tu entends quelqu’un avec une idée en tête qui implique de la musique, des textes, une histoire, un script, des photos, le tout avec une grande ambition alors oui… je me sens plus comme un réalisateur ou un auteur et moins comme un musicien. Et puis, les musiciens qui m’entourent sont bien meilleurs que moi ! J’imagine une musique dans la tête mais je ne sais pas forcément la jouer et j’ai ces personnes formidablement douées qui peuvent le faire.
La musique n’est qu’une partie de l’ensemble.
Steven Wilson : Oui, absolument.
Question habituelle, mais penses-tu que cet album soit ce que tu as fait de mieux ?
Steven Wilson : (rires) Oui ! Bon, à chaque fois on répond oui à cette question et en même temps si je ne le faisais pas, il y aurait un problème. Je dirais stop, tu vois. C’est le problème avec le dernier album de Porcupine Tree, justement. Je sentais qu’il ne s’agissait pas de notre meilleur travail. C’est aussi pour cela que j’ai arrêté le groupe pour passer à autre chose. Alors, oui, je crois que la plupart des musiciens te feront la même réponse : « oui c’est notre meilleur album ». Et je ne suis pas différent.
Une tournée est évidemment prévue. Que pouvons-nous attendre ?
Steven Wilson : Quelque chose de très visuel évidemment. Je travaille avec trois réalisateurs différents pour cela, afin de coller leur univers aux différentes chansons. Il y aura des séquences animées, des séquences live, quelque chose de très multimédia car le concept s’y prête parfaitement.
Tes autres projets ?
Steven Wilson : Aucune idée. Tu sais, cela fait un an que je suis à plein temps sur cet album et cette année devrait être consacrée à sa promotion et à la tournée.
De nouveaux remixes sont-ils prévus ?
Steven Wilson : J’en ai fait vraiment beaucoup ces derniers temps et une bonne dizaine de classiques ne sont pas encore sortis. Le prochain sera probablement un album de Simple Minds.
Est-ce un choix de ta part ?
Steven Wilson : Non. Les gens viennent vers moi, les majors ou les managers, mais je finis par faire fais que ce que j’aime vraiment. Donc, dans un certain sens oui, c’est un choix de ma part. Mais je ne fais pas de suggestions.
Et à propos de Porcupine Tree ?
Steven Wilson : Aucun plan. En fait, je ne sens pas l’obligation de me replonger dedans pour le moment. Le groupe n’est pas mort et je suis persuadé que l’on reviendra un jour, au moins pour un album supplémentaire afin de terminer l’histoire proprement mais je ne ressens pas le besoin immédiat de le faire.
Tu es très engagé dans un processus solo dorénavant…
Steven Wilson : Oui et ça fonctionne très bien. Je n’ai pas la même pression financière ni les mêmes obligations. Mais je comprends que de nombreuses personnes aient un attachement presque romantique avec le groupe. Ils ont parfois grandis avec cette musique et ils voudraient que ça continue toujours mais ce n’est pour le moment pas à l’ordre du jour.
Reste-t-il des musiciens ou des artistes avec qui tu aimerais travailler ?
Steven Wilson : Oui, Kate Bush évidemment. J’adorerai remixer ses albums ou travailler avec elle. Sinon je n’ai pas vraiment de souhait. J’ai déjà travaillé et je travaille encore avec des gens fantastiques. Les musiciens qui m’accompagnent sont extraordinaires donc, non, je n’ai pas d’ambitions particulières. J’ai déjà la chance d’être entouré par les personnes que je voulais.
Et bien merci !
Steven Wilson : Ce fut un plaisir.