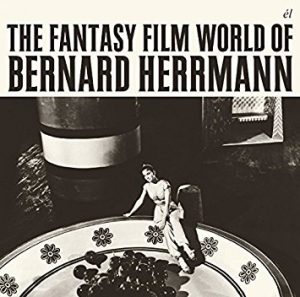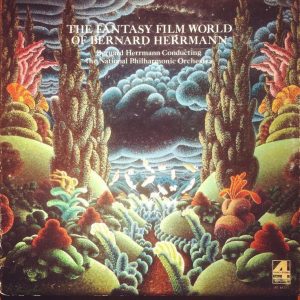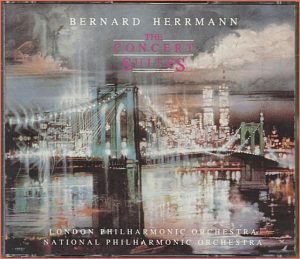Interview très intéressante avec Steven Wilson début 2015.
http://www.leseternels.net/interviews.aspx?id=450
*****************************
Silverbard : Quel est ton regard, dix ans en arrière, de la période In Absentia / Deadwing, ainsi que de la collaboration avec Opeth et de toutes les influences metal qui venaient pour la première fois s’immiscer dans Porcupine Tree ?
Steven : Hum… (avec un accent anglais intranscriptible par écrit) Je regarde cette période avec beaucoup de fierté. C’était vraiment la rencontre de deux mondes. Comme tu le sais bien, Opeth vient d’un milieu death metal et metal extrême, alors que je viens de mon côté de la musique psychédélique et progressive et de l’art rock. Et je me suis intéressé au metal au même moment que Mike s’est davantage intéressé à des formes plus calmes de musique. Donc c’était une rencontre très spéciale d’esprits et d’expériences. Et je pense que tout cela a créé une scène qui est devenue influente sur une longue période de temps. Hum… Il y a beaucoup de groupes qui ont essayé d’imiter ce style. Au début – mais ça n’a pas duré longtemps – c’était juste Porcupine Tree et Opeth. Mais vers 2007-2008, il y a eu de plus en plus de groupes qui ont commencé à sonner pareil. Et à ce moment là, je me suis dit que je ne voulais plus faire ça. Car je pense que quand des groupes commencent à imiter ce que tu fais, il est temps de faire autre chose. Et Mike a ressenti exactement la même chose. Ses fans de la première heure ont souvent du mal à comprendre pourquoi il a retourné sa veste vis-à-vis du metal extrême, et je pense que c’est la raison principale : quand tu entends des groupes te copier jusqu’à devenir la référence d’un propre genre, si tu es un vrai artiste, il est temps de changer. Mais pour revenir à la question initiale, je reste très fier de ces albums, In Absentia en particulier qui est pour moi une grande prouesse artistique personnelle.
Silverbard : Continuons justement sur Opeth quelques instants. Que penses-tu de leur dernier album, Pale Communion, sachant que tu intervenu sur la dernier piste en invité ?
Steven : Brillant ! C’est un album brillant ! Il y a très peu de musiciens actuellement qui peuvent encore me faire tomber autant sous leur charme. Le truc est que quand je suis jaloux d’un morceau, je sais que c’est bon ! Et la première fois que j’ai écouté ce titre “Faith In Others”, j’ai dit à Mikael : « putain, je suis tellement jaloux de cette chanson ! » (rires) C’est réciproque d’ailleurs, s’il est jaloux d’une compo à moi, je sais que c’est un très grand compliment. Le plus grand compliment en effet qu’on puisse recevoir est d’impressionner ses pairs, quelqu’un que tu portes en haute estime, ce qui est évidemment le cas pour Mike. Cette chanson “Faith In Others” est vraiment particulièrement excellente, ses vocaux sur cette chanson montrent en quoi il est un véritable artiste. Parce qu’il n’y a proprement rien qui vienne de la scène metal dedans et rien qui puisse sonner aussi juste.
Silverbard : Ce fut une collaboration à nouveau car tu as participé au mixage de album. A ce titre, comme nous commençons une nouvelle année, quelle rétrospective as-tu de l’année 2014 entre la composition de ton nouvel album, la tournée européenne de Blackfield, les nouveaux remixes, en particulier ceux de Yes… ?
Steven : En vérité, la majeure partie de l’année 2014 a été consacrée à la composition de ce nouvel album à paraître. J’ai composé, enregistré, arrangé, fait des démos, répété, produit, mixé, masterisé… Donc toutes les choses que tu as mentionné ont été faites en complément au milieu de ce gros projet. Mon souvenir global de 2014 est la création de ce grand concept pour cet album et l’écriture de la musique mêlée aux idées visuelles qui se retrouvent dans l’artwork. Ça a été intense. J’ai vécu et respiré cet album et ce personnage que j’ai créé pour l’album. Le mixage de l’album d’Opeth et les autres remixes ont été au final des activités de repos, presque des vacances comparé à Hand. Cannot. Erase. ! Et je pense que les gens ne sont pas forcément au courant de cela parce qu’ils ne savaient pas que je travaillais sur ce nouvel album. Il ne l’ont appris que très récemment. L’année 2014 a été vraiment très intense mais gratifiante, car je suis très fier du résultat !
Silverbard : Petit aparté, comme nous parlions de mixage et mastering à l’instant. J’ai une question au sujet des albums In Absentia et Deadwing qui sont sortis pendant la période « Loudness War ». Il y a un DVD A en 5.1 mais aucun autre mix stéréo que la version de l’album qui est fortement compressée. Est-ce que tu penses avoir l’occasion de les retravailler ?
Steven : Je n’aime pas ce qui a été fait et je veux remastériser ces albums. Mais malheureusement, je ne les possède pas, ils appartiennent à Warner Bros. Et tant qu’ils ne voudront pas faire de réédition ou me léguer les droits pour que je puisse les racheter, je n’ai aucun moyen d’action. Ils n’ont pas été mal masterisés, le travail a été bien fait, mais ils sont sortis à une période où tout devait être aussi fort que possible. Et ce n’est pas agréable d’écouter des albums qui sonnent fort comme ça tout le temps. Donc oui, j’adorerais remastériser ces albums, espérons que ça se produira un jour.
Silverbard : Pour continuer sur ce point, j’ai entendu que pour l’album Fear Of Blank Planet, tu as d’abord donné les mixes à l’ingénieur chargé du mastering, mais une fois le master reçu, tu n’as pas été satisfait du travail fait et tu as remastérisé l’ensemble après coup.
Steven : C’est tout à fait vrai. Je l’ai fait par moi-même. C’est la première fois que ça m’arrivait et je suis sûr que je ne l’ai pas très bien fait. Mais au moins, j’étais capable de garder bien plus de dynamiques dans la musique. C’est un moment dans la musique où j’ai compris que je ne voulais plus que des personnes extérieures viennent tripoter mes mixes, les compresser, etc… Le problème est que pour beaucoup de gens, le mastering se résume à monter le volume, compresser et alourdir les aigus et les basses. Ce n’est pas très musical tu sais… Surtout pour mon style de musique. Ça pourrait être bien si tu es Rage Against The Machine, okay. Faire un album qui sonne fort et punchy tout le temps. Mais pas pour mes compositions qui sont très dynamiques… Et progressivement au cours des dernières années, j’ai essayé de convaincre de plus en plus de gens de publier des albums sans mastering. Le nouvel album d’Opeth a été réalisé sans aucun mastering. Ça s’appelle un « flat transfert ». Et les gens l’aiment, les gens adorent le son. La chose que je n’ai jamais entendu dire de personne à propos de tous ces albums est : « C’est un très bon album mais il aurait été meilleur masterisé ». Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire cela ! (rires) Je pense que c’est juste un mythe de vouloir masteriser ses albums, du moins dans le style que j’exerce.
Silverbard : Quelle est ta philosophie pour tes dernières parutions, quels sont tes choix concernant le mastering ?
Steven : Il n’y en a pas. Je mixe les titres et ils sont transférés tels quels sur le CD ou le vinyle. Je fais cela pour tous mes albums depuis au moins quatre ou cinq ans.
Silverbard : Parlons à présent du nouvel album, qui parle de la tragédie réelle d’une femme qui est décédée seule dans son studio et dont le corps est resté non découvert pendant deux ans. Pour te citer, tu as dit que « l’histoire semble si symptomatique du monde moderne, de l’idée que dans une ère de réseaux sociaux, on est entouré de millions de gens, mais que de l’autre côté du mur, on est complètement isolé ». Pourquoi penses-tu que c’est une tragédie révélatrice de notre époque et quelles causes pourraient expliquer cela ? L’ignorance réciproque des gens ?
Steven : Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, la vitesse de notre rythme de vie nous dépasse et nous avons une vision confuse de la vie. Nous sommes submergés en permanence par la technologie, le monde est de plus en plus surpeuplé et stressant. Je pense qu’il y a de ce fait une tendance croissante chez les gens de ne pas vraiment s’aventurer hors de leur chambre. Regarde les jeunes générations maintenant qui interfère très bien par le biais d’un ordinateur. Je peux parler avec mes amis par emails, Skype, Facebook… Je n’ai pas besoin d’aller dehors, je n’ai pas besoin d’aller dans un bar, je n’ai pas besoin d’aller à un spectacle, je n’ai pas besoin d’aller à une soirée… Je n’ai besoin de rien de tout ce bordel ! Je peux avoir de la pornographie sur mon ordinateur, je peux avoir de la musique sur mon ordinateur, je peux parler à mes potes sur mon ordinateur, pourquoi aurais-je besoin de sortir de chez moi ? Je pense que chacun peut un peu se retrouver là-dedans. Quiconque sur Terre a déjà été confronté à cette situation : pourquoi ai-je été invité à cette soirée, à ce dîner, à ce spectacle ? Je crois que je vais rester chez moi et regarder la télé. Et ce sentiment, qui pourrait paraître assez joyeux et content, car nous pouvons tous comprendre ce sentiment – nous avons tous besoin de temps pour nous – masque une tendance croissante, particulièrement dans les grandes villes. Plus la ville est grande, mieux on disparaît. Nous voyons tous ça autour de nous à présent : plus il y a de gens, plus facile cela est d’être invisible. C’est une tendance croissante de nos jours – et je ne pense pas que ce soit une bonne – Internet l’augmente évidemment, la télévision également, alors que l’interaction humaine réelle devient de moins en moins présente, particulièrement chez les enfants. Je parle de la capacité de communiquer comme des être humains. J’ai vu des enfants récemment qui m’ont dit : « pourquoi ai-je besoin d’apprendre à écrire maintenant ? » Je peux taper sur mon clavier et ils ont raison, c’est vrai. Il n’y a plus de vraie raison aujourd’hui de savoir écrire avec un stylo et c’est très dur de débattre sur ce sujet. Mais c’est la même discussion que tu auras avec le même enfant qui te demandera : « pourquoi je dois payer pour écouter de la musique ? » C’est dur de lui expliquer et de bien justifier pourquoi il devrait avoir cette connexion avec cette œuvre d’art qu’il tiendrait dans ses mains… C’est comme s’il venait d’une autre planète.
Je suppose que je quand j’écris des chansons sur ce sujet, ce que j’essaie de faire est de tenir un miroir et de dire : « Ceci est ce que je vois. Te reconnais-tu dedans et crois-tu que c’est bien ? » Des gens pensent que oui ! Des gens pensent qu’Internet est formidable, qu’on n’a plus besoin de sortir dehors et d’être des humains ! Parfait, si c’est ce que tu penses ! (rires) Mais la plupart des gens qui regardent dans ce miroir sont d’accord avec moi – du moins jusqu’à un certain point – que ce n’est pas une bonne tendance et ce n’est pas ce que symbolise l’espèce humaine. Ce n’est pas l’isolation, la déconnexion… Mais je trouve que la ville du XXIème siècle devient un lieu où ceci est de plus en plus apparent, où de plus en plus de gens s’enferment et deviennent cinglés… C’est évidemment quelque chose qui me préoccupe et mes chansons parlent de ce qui m’inquiète. Je n’écris pas des chansons sur : « Hey ! La vie est géniale ! ». J’écris des chansons sur : « C’est la merde ». J’ai toujours été comme ça, j’ai toujours été plus attiré par les choses que je ne comprends pas, qui me tourmentent, qui sont négatives, plutôt que par les choses qui me rendent heureux. Quand je suis joyeux, je sors dehors et je promène mon chien ! Quand je suis agacé au sujet de quelque chose, c’est à ce moment que j’écris de la musique. Et ça devient presque comme de l’exorcisme de ces choses. Et cette histoire n’est pas différente. Cette histoire n’est pas sur Joyce Carol Vincent (NdlR : c’est le nom de la protagoniste suscitée), elle a été la base de la réflexion de ce problème et m’a permis de créer ce personnage, qui au final est moi. Les expériences et les idées qu’ont ce personnage sont les miennes. Et je peux comprendre. J’ai vécu à Londres pendant vingt ans. Pendant longtemps, je n’ai même pas connu le nom de mon voisin de palier, je ne savais pas ce qu’il faisait, et réciproquement. J’ai déménagé hors de la ville, seulement à 30km dans une petite bourgade, et en moins d’une semaine je connaissais le nom de tous les gens qui vivaient dans ma rue ! Je connaissais mon facteur, je connaissais la fille qui travaillait au comptoir de la boutique en face, je connaissais la police, je connaissais tout le monde ! C’est si étrange, car quand je vivais à Londres, je ne connaissais absolument personne ! Il y a vraiment quelque chose de très particulier au sujet de la métropole et… (s’interrompt) Mais désolé, c’est une très longue réponse ! (rires)
Silverbard : Non c’était très intéressant ! J’ai lu que ce documentaire qui t’as fait prendre connaissance de cette histoire, « Dreams Of A Life », tu l’as découvert pour la première fois en 2011.
Steven : Oui très récemment !
Silverbard : Quand as-tu pensé que ça deviendrait une source d’inspiration pour un album ?
Steven : Et bien, c’est assez simple car je n’y ai jamais pensé en fait… Jusqu’au jour où j’ai dû écrire de la musique nouvelle. Je pense que c’est toujours le cas chez moi. Je trouve quelque chose que j’ai vu, ou que j’ai lu, ou que j’ai vécu, qui est resté avec moi et qui a continué à me hanter pendant des semaines, des mois, voire plus… Et l’histoire de Joyce Carol Vincent en fait partie. J’ai vu le film et ça n’a pas fait « Bing-bong. CA VA ÊTRE LE CONCEPT DE MON PROCHAIN ALBUM !! » (NdlR : talent caché de Steven Wilson dans les imitations). Pas du tout. J’ai simplement vu le film, j’ai été très ému et affecté et je n’ai rien vu de plus à son sujet, à l’exception du fait que je continuais à y penser, à être hanté par celui-ci. Un an plus tard, j’ai commencé à écrire – pas à propos de Joyce Carol Vincent – mais d’un personnage qui vivait dans un HLM au cœur d’une mégalopole et qui ressentait ce sentiment croissant d’isolement et de confusion. Et c’est comme ça qu’a débuté le concept de l’album. Au fur et à mesure des mois, l’histoire est devenue de plus en plus complexe et s’est beaucoup éloignée de Joyce Carol Vincent en « science-fictionnisant » mon histoire. C’est devenu beaucoup plus que l’histoire originale, mais le germe initial était dans mon esprit depuis plus de deux ans ! Et il était toujours là, je ne parvenais pas à l’oublier, c’est ça le plus important.
Silverbard : Passons à présent à la musique, j’ai remarqué que l’album contient des couches électroniques sur plusieurs chansons, ce qui est assez nouveau d’une certaine façon. Pour moi, tu n’étais jusqu’à présent jamais allé aussi loin dans cette facette. J’ai lu les noms de Boards Of Canada ou Aphex Twin comme sources d’inspiration. Je ne suis pas étonné que tu aimes de tels groupes, considérant les atmosphères qu’ils développent. Ont-ils été une source particulière d’inspiration pour cet album ?
Steven : Oui, j’écoute ces gars depuis longtemps, mais je pense que tu as raison quand tu dis qu’ils ne se sont pas nécessairement manifestés si profondément dans un projet que cette fois-ci. Je pense qu’il y a deux raisons qui expliquent pourquoi maintenant. La première est que mon précédent album The Raven That Refused To Sing n’avait aucun élément électronique, c’était le parfait opposé. C’était un sorte d’album vintage sonnant seventies tout comme Opeth l’a fait. Et j’y vois une sorte de réponse à ce précédent album, car je déteste me répéter. Je voulais vraiment faire quelque chose de complètement différent. Et la chose évidente, quand tu veux faire l’opposé d’un album rock seventies, est d’apporter des éléments électroniques contemporains. Le deuxième point est que le concept de l’album est contemporain du XXIème siècle et porte sur la métropole. Donc directement, tu penses à une palette de sons électroniques, voire industriels. Parce que tu essaies avec cela d’apporter les sons de l’âge moderne de la ville. Ça prend donc du sens du point de vue conceptuel.
Silverbard : Comme composeur, quels sont les facteurs humains et musicaux qui te font travailler avec un musicien en particulier plutôt qu’un autre ? Comment est-ce que ces facteurs ont évolué depuis le début de ta carrière ?
Steven : Hum… C’est une question assez profonde ! (rires) Premièrement, ce qui m’attire quand je travaille avec un musicien en particulier est bien sûr le respect de son talent. Mais pour moi personnellement, c’est aussi d’avoir la capacité de me surprendre avec quelque chose auquel je n’aurais pas pensé par moi-même. Il y a certes beaucoup de musiciens qui peuvent me surprendre, mais pas forcément avec ce que je recherche… Mais si tu trouves un musicien, mais pas seulement un musicien car ça peut être également un collaborateur visuel par exemple, qui est un gars en qui je peux faire confiance pour faire des choses auxquelles je n’aurai jamais pu pensé seul, alors je vais l’adorer. Ces personnes sont très rares. Pas seulement pour moi, mais je pense pour chaque artiste. De trouver quelqu’un qui est assez proche de ta sensibilité artistique pour te dégoter une idée géniale mais qu’à la fois tu n’aurais pas pu trouver toi-même… J’ai passé beaucoup de temps à chercher de tels gens, mais je me sens vraiment chanceux de les avoir trouvé à présent. J’ai ce groupe de gens autour de moi qui sont premièrement des musiciens extraordinairement talentueux, mais ils ont surtout une forte affinité avec mon monde créatif. Je sais que leurs idées vont bien sonner et résonner avec les miennes. Et ça m’a pris vingt ans pour trouver ces artistes et musiciens. Ça vaut bien sûr pour les gens dans mon groupe, car j’ai été dans beaucoup de groupes dans ma carrière, et je n’ai jamais ressenti cela. J’ai vraiment trouvé au fil des années des personnes en qui je fais confiance et avec lesquels je ressens une véritable connexion, que soit Mikael ou les musiciens de mon groupe, ou Lasse Hoile qui fait beaucoup de mes visuels.
Silverbard : The Raven That Refused to Sing est devenu l’album à la fois le plus vendu et le plus acclamé de ta carrière, après vingt ans et trente albums parus. Tu as aussi affirmé que c’était un sommet pour toi. Dans quel état d’esprit as-tu été quand tu as composé Hand. Cannot. Erase. ? T’es-tu senti sous pression ?
Steven : Le seule pression que j’ai ressenti ne venait pas des fans, ni du label ou du management, ni encore du reste du groupe, mais de moi et moi seul. Et la plus grande pression que j’avais était de ne surtout pas vouloir me répéter. Je pense que ça aurait été très simple de sortir The Raven That Refused To Sing Part 2, vu le succès que cet album a eu. Et en fait, le label et le management auraient été ravis, certains fans – pas tous – aussi. Mais je ne peux pas. C’est si ennuyeux. C’est créativement vide de refaire la même chose… à nouveau. La pression que je me suis donnée a donc été de faire quelque chose de complètement différent. Il y a toujours ma personnalité, mais c’est une expérience qui n’a rien à voir. Le concept a beaucoup aidé à cela, à m’emmener dans une direction moderne opposée. J’ai aussi voulu apporter des couleurs musicales différentes, j’ai travaillé cette fois-ci avec une chorale, ce qui était une exclusivité, de même qu’avoir une chanteuse très présente, où l’écriture des mélodies vocales était très originale… Mais au final, cette unique pression personnelle a été sûrement la plus grande que je pouvais avoir ! Il est possible de faire face aux pressions extérieures, mais quand je ne parviens pas à me satisfaire moi-même, je déprime beaucoup. Au milieu du processus de composition, ça n’allait pas bien du tout, j’ai été extrêmement déprimé. Ça a été une épreuve, parfois dure et peineuse, parfois exaltante et joyeuse. Quand je trouvais une bonne chanson, tout allait au mieux, quand je stagnais, tout allait au plus mal…
Silverbard : Et comment te sens-tu maintenant ? (rires)
Steven : Je me sens que je ne l’écouterai plus jamais ! (rires) Mais j’en suis très fier cependant, si tu comprends. J’ai dédié un an et demi de ma vie à le construire entièrement et à présent je dois penser à le reproduire en live – ce qui est fun, car ça n’a rien à voir – mais je ne veux plus jamais écouter cet album ! Cependant… Je pense que c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. J’ai cette très étrange relation… Comme toujours ! C’est la même chose pour chacun de mes albums. Je pense que c’est pareil pour beaucoup d’artistes.
Silverbard : Merci infiniment pour cette interview !
Steven : Merci, le plaisir est pour moi.