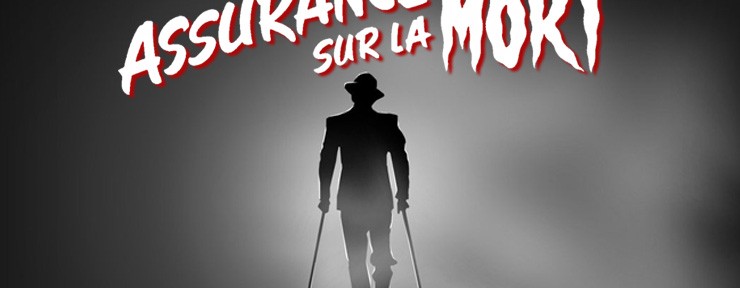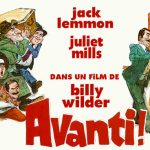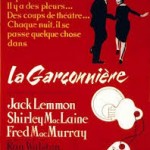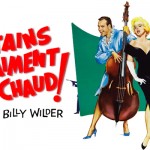Dans une piscine classieuse de Sunset Boulevard à Hollywood, on retrouve le cadavre d’un homme criblé de 3 balles. En voix off, on apprend que cet homme qui rêvait d’une belle piscine en a maintenant une mais il l’a payée cher. Avant l’arrivée des journalistes « people », voici la véritable version sur la mort de cet homme. C’est un jeune auteur (Joe Gillis – William Holden) qui tente de survivre en écrivant sans grand succès des projets de film. Criblé de dettes, il essaye d’échapper à ses créanciers qui veulent saisir sa voiture. Lors d’une course poursuite, il crève et échappe à ses poursuivants en garant sa voiture inutilisable dans une énorme et lugubre baraque au 1086 Sunset Boulevard. En parcourant les lieux, il découvre une dame d’âge mur ancienne gloire du cinéma muet (Norma Desmond – Gloria Swenson) et son majordome (Max von Mayerling – Erik Von Stroheim). Ces deux personnages étranges et sinistres pensent d’abord que c’est le croquemort qui vient pour mettre en bière un singe puis Norma apprend que Joe est un écrivain sans le sous. Elle décide de l’engager pour remettre en forme le scénario de son cœur et marquer son retour retentissant au cinéma avec « Salomé ». Le scénario est mauvais et égocentrique et Norma ne cesse de regarder son image passée mais Joe a besoin d’argent. Peu à peu elle tombe amoureuse de lui et la maison devient une prison dorée. Joe se prostitue. Quand il parvient à s’échapper, il retourne aux studios « Paramount « à Hollywood et tente de vendre ses scénarii. Sans grand succès sauf auprès d’une jeune et influente « lectrice » de scénario (Betty Schaefer – Nancy Olson), enthousiaste et ambitieuse qui voit dans Joe l’opportunité de se faire un nom. Elle lui propose de reprendre l’écriture d’un scénario. Presque chaque nuit, échappant à sa prison dorée et étouffante, Joe va retrouver Betty pour poursuivre son scénario. Elle tombe amoureuse de lui et lui a bien du mal à résister. Mais Norma est jalouse.
Comme Double Indemnity, Sunset Boulevard est noir et implacable. Son “héro” est un homme plutôt pauvre qui cherche à vivre mieux qui a besoin d’argent pour survivre. Comme Walter Neff, il choisit un mauvais chemin (Walter c’était le meurtre, lui la prostitution) et fait une mauvaise rencontre. On imagine toujours qu’il y a une porte de sortie, le « héro » garde une étincelle de moralité mais on est dans le drame et la tragédie. Comme dans « Assurance sur la mort » on connait les faits dès le début sauf que tout n’est qu’apparence. On est dans le cinéma sur un film parlant du cinéma. Le scénario est implacable, chargé d humour noir et d’absurde, critique acerbe du monde du cinéma, des trames avant qu’un film ne se réalise. Les actrices féminines sont magistrales et William Holden est pathétique et beau à la fois, Norma est grandiloquente, triste et décadente, Betty joyeuse et séduisante. Max en majordome digne et mystérieux est magistral. Comme toujours chez Billy Wilder, les seconds rôles sont aussi étoffés et bons que les premiers. La voix off distille des pensées pertinentes, comiques et acerbes. Les dialogues sont justes. On n’est pas dans le cliché sur le cinéma (un monde que Billy Wilder croque avec lucidité et précision). On est dans le drame passionnel autant que le film noir. La photographie joue sur tous les codes du noir et blanc, le clair obscur (les visages de Norma), l’ombre (la route de Sunset Boulevard, la grande maison de Norma) et la lumière (Betty dans la fausse rue, Joe dans ses tenues d’apparat) n’ont jamais été aussi bien associés. Il n’y a pas la nostalgie du cinéma muet ni la critique du cinéma en bloc. Hollywood est implacable pour les anciennes gloires qui ne sont plus à la lumière ou pour les artisans qui ne se font pas de nom.
David Lynch a rendu hommage à ce film avec « Mulholland drive » : Betty (Naomie Watts) rappelle la Betty et son sunset Boulevard sombre et mystérieux est le même que celui de Billy Wilder. La brune (Laura Harring) pourrait être la Norma qui va descendre aux enfers. Elle regarde son visage comme Norma et erre dans Sunset Boulevard sans plus savoir qui elle est. Il y a aussi « Gordon Cole » et « Norma Desmond » dont Lynch a remprunté le nom dans « Twin Peaks ». Dans une scène de Sunset Boulevard Betty dit devant un décor de rue de studio « j’aime cette rue, tout n’est que carton, décor, imitation, tout n’est qu’illusion mais j ai grandi avec ça ». Plus tard Lynch filmera la scène du « silencio » où tout n est qu’illusion.
Plus varié qu’assurance sur la mort si on doit trouver un mieux, Boulevard du crépuscule est devenu mythique, il n’a jamais été refait ou égalé (puisque ce genre n’existe plus vraiment) et unique car l’œil de Billy Wilder est unique. Par la suite, dans ses autres films, Billy Wilder va emprunter quelques codes du film noir mais sans jamais vraiment retourner dans un genre qu’il aura parcouru avec talent.