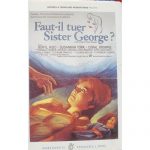“Faut il tuer Sister Georges” est un film “coup de poing” de Robert Aldrich : un film excellent à découvrir mais qui n’est pas forcément facile à appréhender ni par le sujet ni par la mise en scène.
- Critique du monde de la télévision
Robert Aldrich a travaillé à ses débuts comme réalisateur à la télévision : il connait ce monde dont il dresse un portait féroce impitoyable. Sister George est le personnage principal et populaire d’une série (prude !) qui va peu à peu être évincé. Les productrices et scénaristes sont motivées par l’audience, la rentabilité et la popularité. L’actrice va sombrer lentement.

- Duo d’actrices
June (Sister George) (Beryl Reid) et Childie (Susannah York) sont les deux personnages principaux et leur prestation est éblouissante. June est tour à pathétique et émouvante, vulgaire, sensible, manipulatrice. Childie est alternativement dure, fragile, séduisante, esclave et manipulatrice. Robert Aldrich pousse ses deux actrices au bout (à bout ?) dans des scènes difficiles à la fois nuancées et outrancières.
- Mis en scène, mise en abîme
Le film est long (2h20), éprouvant mais envoûtant, intense avec de longues scènes où on ne sait si l’on va sourire (un peu) ou être triste (touché). La mise en scène est une lente mise en abîme d’une actrice, d’une femme, d’un couple.
- Lesbiennes
Robert Aldrich qu’on n’a jamais pu qualifier de réalisateur aux idées manichéennes, simplistes, machistes (malgré les apparences – films de guerre, westerns) aborde le thème de l’homosexualité féminine, avec nuances mais néanmoins frontalement.
- Films engagés
Robert Aldrich après le succès des 12 salopards 1967 (film pas aussi simpliste qu’il n’y parait), réalisent en 1968 deux films engagés et critiques sur le monde du cinéma (The Legend of Lylah Clare) et de la télévision (The Killing of Sister Georges ).
Alors The Killing of Sister George (être en forme pour le visionner) difficile de sortir joyeux mais aussi reconnaissons qu’on peut être touché par un film fort et unique.
- Extraits
Une scène (poignante) : June vient d’apprendre qu’elle perdrait son role dans la série Sister George. Elle écrit des (fausses) lettres de spectateurs mécontents. Childie tente de la réconforter mais se détache peu à peu d’elle.
Scène June Childie : le personnage sister George a disparu de la série
June retrouve un peu d’enthousiasme. Elle part avec Childie dans un bar lesbien faire un numéro de Laurel et Hardy.
Scène June Childie en Laurel et Hardy
Pour aller plus loin
Analyse (objectif Cinéma) par Sébastien MIGUEL
The Killing of Sister George
de Robert Aldrich
Par Sébastien MIGUEL
SYNOPSIS :
June Bukridge est une actrice de télévision anglaise qui connaît un certain succès pour son rôle de joyeuse nurse de campagne nommée Sister George. Elle vit tranquillement avec sa compagne Childie jusqu’à ce que son émission et son couple soient menacés par l’arrivée d’un producteur télé, prêt à tout pour réussir.
…………………………………………………………..
ANALYSE
Killing of Sister George est une œuvre cinématographique. Œuvre de ces hommes qui n’ont reculé devant rien pour affirmer leur vision du monde à travers des productions libres de toutes contraintes, de tous protocoles. Quitte à faire un bide.
De tous les films sans contrainte d’Aldrich, Sister George est peut-être le plus intransigeant, le plus terrible. Comme si la rancœur accumulée et les grandes frustrations de ses projets inaboutis ou ratés des années 60 (cf. : Taras Boulba ) s’étaient enfin libérées dans ce premier film en tant que producteur indépendant. Tourné dans ses propres studios, The Killing of Sister George fut la première réalisation d’Aldrich libre de tout tutorat. Projet insensé et complètement fou pour un producteur mais finalement tout à fait logique de la part d’un individualiste comme l’était Aldrich.
Lorsqu’on lui pose la question, en ce milieu 68 (quelle date !), Aldrich se contente de dire de manière laconique : « Je vais faire Sister George parce que je pense qu’il s’agira d’un bon film… ». Certes, mais une telle réponse refusait d’évoquer la teneur-même de la pièce de Franck Marcus. Bien sûr, en substance, il s’agissait d’une critique tonitruante du monde de la télévision à travers l’histoire de June, l’une de ses vedettes : la comédienne interprétant la Sœur George à l’écran. Une adorable petite religieuse qui passe sur sa petite mobylette à l’intérieur d’une charmante petite commune typiquement anglaise avec son pub, ses villageois… Une critique acerbe puisque la chaîne décidait d’éliminer le personnage que jouait June. Purement et simplement.
Mais la pièce de Marcus abordait aussi avec crudité la relation lesbienne sans équivoque de la Sœur George avec sa petite amie. Car si à l’écran Sister George est adorable, à la ville il s’agit d’une grosse vache alcoolique terrorisant et torturant de manière monstrueuse sa petite amie… Perdant sa célébrité, et donc le seul attrait (croit-elle) de sa misérable existence, June va voir disparaître tout ce à quoi elle tenait : sa notoriété et son amie.
Retrouvant le scénariste Lukas Heller ( What ever happened to baby Jane ?) et détruisant tous les tabous sur son passage, Aldrich va nous décrire avec une minutie et un radicalisme sidérants l’inexorable chute de June… Pendant plus de deux heures, à travers ce portrait Aldrich nous livrera l’un de ses monstres les plus incroyables et probablement le plus pathétique (cf. : Aldrich, l’usine à monstres). Ici, tout est mis en œuvre pour révulser ou provoquer le malaise. D’ailleurs le premier plan du film annonce déjà l’inexorable, le dernier – le même que dans The Big Knife – est impitoyable. Si Aldrich ne se permet évidemment pas de contourner la trivialité de certaines séquences (la descente dans une boîte lesbienne ou la fameuse scène de saphisme), il se délecte visiblement en renforçant un certain misérabilisme. Le décor : le Swinging London des années 60 est réduit à la presque complète unité d’un seul espace. Ici, l’appartement de June concentre presque toutes les étapes importantes du récit. Exigu et rempli de zones d’ombres, c’est un lieu où l’on sent peser le poids du destin. Comme The Big Knife , où tout le film se déroulait dans un seul et même décor (un rez de chaussé étouffant), la grande théâtralité est fortement mise en valeur mais, comme toujours, détruite par la mise en scène à la fois simple et violente.
Il en va de même pour les couleurs, la musique et les costumes… outrageusement kitsch, d’un mauvais goût systématique. Il semble être le reflet d’une histoire presque banale, ancrée dans un quotidien des plus sordides. Il n’est pas stupide de penser à l’univers d’un autre cinéaste : Sister George annonce par instants certains films de Rainer Fassbinder, notamment le Faustrecht Der Freiheit tourné en 1974. Comme Baby Jane ou All the Marbles , Sister George fait partie des films d’Aldrich où tous les personnages principaux sont des femmes. Mais si l’homosexualité féminine pouvait encore apparaître dans All the Marbles , ici elle devient le théâtre d’un incroyable malaise.
Il n’y a aucun glamour dans les films d’Aldrich puisque, pour lui, la bassesse, la laideur et la bêtise font partie intégrante de la nature humaine. Alors oui : June / Sister George est un monstre. La scène de torture à la cendre de cigares révèle dans toute son horreur la suprématie machiste que Sœur George tente d’imposer à sa petite amie. Les Guignols de la télé, tous hideux et grotesques, ne sont qu’une bande de clowns imbéciles, continuant inlassablement la fabrication de séries insipides et consternantes. Les bourgeois (remarquable Coral Browne ) ne sont que des hypocrites cachant des instincts bestiaux des plus répugnants. La scène de sexe entre Susannah York et Coral Browne est filmée comme un crime, un acte horrible… insoutenable.
Perpétuellement et régulièrement, le film est entrecoupé d’extraits mielleux de la stupide série Sister George. Comme Bette Davis dans Baby Jane ou Hush … Hush , Sweet Charlotte l’interprétation principale constitue le moteur de l’œuvre. Beryl Reid incarne avec une emphase hors norme cet être à la fois répugnant et profondément pathétique. Elle est vieille, grosse et alcoolique. Il faut l’avoir vu parodier Stan Laurel dans une boîte lesbienne avant de la retrouver un peu plus tard, après l’annonce de sa mort par le studio. De la vulgarité totale, elle parvient à passer (parfois dans une seule et même scène) à l’abattement le plus complet, le plus bouleversant. Elle est seule et sa seule amie, une call-girl de luxe, lui permet tout juste de venir pleurer chez elle.
Sister George devient alors l’une des plus terribles dégringolades jamais filmées. On a taxé le film à l’époque de « vulgarité misérabiliste » (il fut classé X par la censure). Pourtant, il est évident que le regard porté sur l’existence de June est précis et exhaustif. Si les réactions furent à ce point hostiles au film, c’est peut-être parce que rares sont les œuvres où un cinéaste se penche avec autant de compassion sur la déchéance humaine.
Le regard de Robert Aldrich est bien sûr satirique, provocateur, mais aussi profondément humain, empreint d’une compassion et finalement d’une tendresse presque sans pareille pour ces monstres qui, lorsqu’ils chutent, révèlent toute leur humanité déchirante. Finalement, la tendresse est peut-être le véritable sujet du film, ou plutôt son absence dans notre monde. Comme lorsque la caméra filme en gros plan le visage de Beryl Reid qui, entre deux whiskys, cite Sidney Greenstreet , le gros bonhomme dans les films. Son regard se perd, et elle murmure : « Il n’y a pas assez de tendresse dans ce monde ».